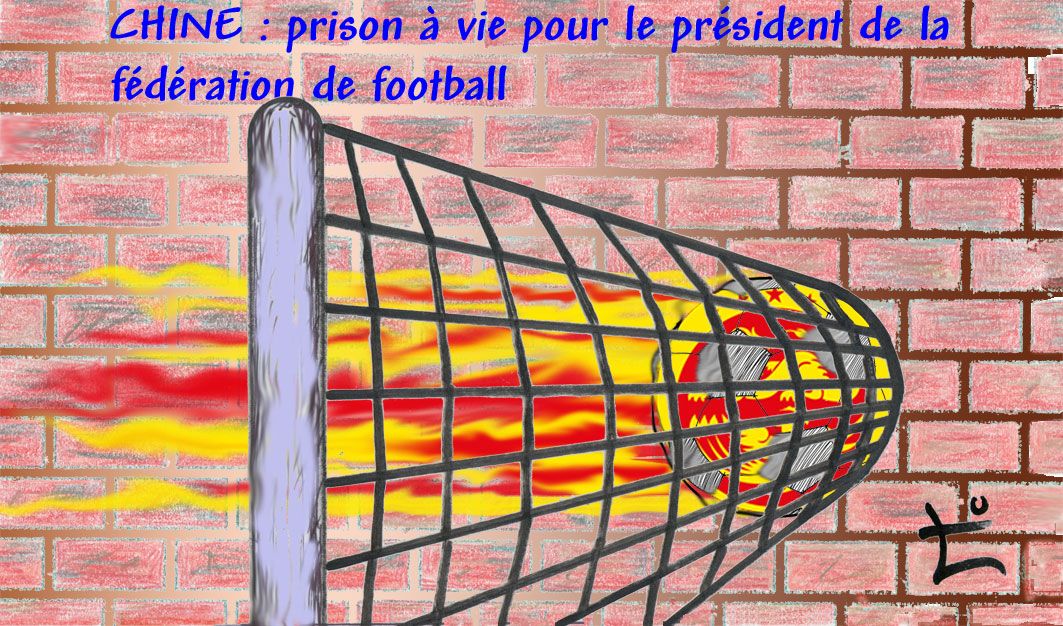Le Silence des Rizières est un SUPERBE documentaire, historiquement plutôt bien cadré, avec des choix assumés sur le traitement du sujet, qui en fait ne se veut pas « historique » au sens propre, mais s’inscrit parfaitement dans l’Histoire… C’était vraiment très émouvant et lors de la discussion, un monsieur asiatique, totalement bouleversé nous a dit que « Roland » (communiste engagé au côté du Vietminh pour la libération du Vietnam) était son beau-père, et qu’il venait de découvrir ce qu’il avait fait ! C’était vraiment un moment très fort. La réalisatrice est un petit bout de jeune (très jeune) femme avec les deux pieds bien sur terre, extrêmement structurée, qui assume totalement ses choix et ses impasses pour son film… Un grand moment de petit bonheur : MERCI !
(Myriam, spectatrice)

Qu’a pensé Maï du résultat final ?
Le chemin a été long mais aujourd’hui elle se sent à sa place. Elle peut distinguer le destin de ses parents du sien. Elle est née à la fois du colonialisme et de la résistance. C’était caché, elle ne devait pas parler. En faisant ce film elle désobéissait à son père, c’est pour cela qu’elle a eu autant de mal à s’exprimer, maintenant elle le fait, elle est beaucoup plus à l’aise, même si je ne crois pas à la vertu des films qui soignent. Elle était très soucieuse de réhabiliter l’action de son père et je crois que de ce point de vue-là c’est réussi.
Qu’en est-il de ses parents ?
Thuy Cam, la mère de Maï, était dans un processus de reprendre sa place dans son propre pays. Il y a une séquence qui explique qu’en se mariant elle a quitté sa famille, son pays, elle a sacrifié beaucoup et elle n’a pas trahi sa famille. Il y avait énormément de non-dits et l’émotion ressort : il y a des séquences où elle essaye d’exprimer ce qu’elle a ressenti, comment elle a vécu cette distance à l’époque.
Elle était en France mais ne racontait pas du tout à sa famille que ce n’était pas la vie qu’elle avait imaginée. En même temps, je ne souhaitais pas rentrer dans leurs règlements de comptes, d’autant plus que le père de Maï était absent. Finalement l’absence du père est très fertile pour la construction du film. Lors du montage je me demandais, comment vais-je faire s’il accepte de parler ? Il sait que le film existe mais, pour l’instant, il n’a pas souhaité le voir car cela évoque trop de souvenirs. Ce n’est pas qu’il ait peur de quoique ce soit mais je pense que c’est une tâche tellement lourde, en plus les parents de Maï se sont séparés il y a une vingtaine d’années.
Vous avez travaillé avec Jean-Luc Godard, est-ce qu’on peut voir des influences dans votre travail ?
Je ne parlerai pas d’influences mais par contre j’ai le sentiment d’appartenance à une certaine forme de cinéma que j’affectionne où on est plutôt dans une forme de documentaire très subjectif par exemple, j’ai été nourrie de ce cinéma-là : celui de Cramer, de Marker, ou de Godard d’une autre façon, mais c’est plus dans leur approche : ces cinéastes se considèrent comme des artisans, et ont une manière de travailler qui le justifie.
Dans chaque personne qu’ils rencontrent, ils essayent de déceler la part de fiction qui est en elle. On est engagé dans ce processus-là, quand on est avec Godard, on ne travaille pas à cinquante mais à cinq personnes. Du coup, on est plus impliqué par le sens et la réflexion tout en restant dans le basique. On n’est pas forcément dans la théorie avec Godard, lorsqu’il demande de trouver tel objet pour telle séquence, de faire répéter telle actrice de telle façon, c’est une manière d’appréhender le réel qui demande une certaine forme d’humilité et peut-être que j’affectionne ce climat-là. J’ai travaillé avec des gens comme Jean Michel Carré qui appartient plutôt à une veine de cinéastes militants qui s’attachent beaucoup à des gens en marge, en résistance, dans la prostitution par exemple. Finalement tout ce qui est dans la brèche c’est ce qui m’intéresse car c’est ce que je vois.
Existe-t-il un lien entre votre intérêt pour ce que vous voyez et votre filmographie essentiellement constituée de documentaires ?
Il n’y a pas de différence pour moi entre la fiction et le documentaire si ce n’est que la fiction c’est chercher ce qu’il y a de plus réel dans les gens et le documentaire ce qu’ils ont de plus fictionnel.
Ces dernières années, j’ai été obsédée par les histoires de traces et de retour dans le passé, ce qui nécessite une construction un peu romanesque, un peu alambiquée, un peu “littéraire”, du coup j’ai envie d’écrire un film de fiction, mais j’ignore si je travaillerais avec des comédiens professionnels ou non, j’aime bien cette espèce d’ambiguïté.
Ce n’est pas forcément simple mais il y a peut-être une façon poétique d’exorciser l’austérité du monde.
L’économie du ciel, votre premier long métrage est en cours d’écriture, peut-on en connaître le sujet ?
C’est l’adaptation libre d’un roman autobiographique de l’écrivain suisse Jacques Chessex qui est très bressonien dans le récit. C’est l’histoire de personnes qui cherchent l’envol et qui ne le trouvent pas. Le personnage principal, en rentrant de l’école, croise son père sur le chemin, qui lui dit “tu ne m’as jamais vu à ce moment-là et tu ne diras pas que tu m’as vu”. Peu de temps après on apprend qu’une vieille femme est malencontreusement tombée par la fenêtre et qu’elle en est morte. On comprend alors que cette femme avait été le témoin d’une relation entre le père du personnage et une autre personne. Il y a toute une reconstruction autour de cet événement traumatisant et d’un suicide. Mais je n’en suis actuellement qu’aux prémices, j’ai encore beaucoup de travail qui m’attend.
Vous avez aussi travaillé avec David Carr-Brown pour une soirée Thema sur la Corée en 2000?
Ce fut un heureux hasard. David Carr-Brown est plutôt orienté vers une forme de cinéma documentaire d’investigation qui est aussi une écriture télévisuelle, qui vaut ce qu’elle vaut. Ce sont des sujets éminemment politiques et personnellement, j’avais besoin de me frotter à ça car j’appartiens à une génération d’enfants d’après 68, à laquelle on n’a pas vraiment légué ou transmis quelque chose, même si nous ne sommes pas forcément dépolitisés. Faire de la politique ça ne m’intéresse pas mais c’est faire un film politiquement qui m‘intéresse, vous savez l’amour peut être politique. Il y a de nombreuses façons de considérer, de chercher et de prendre un point de départ, cette expérience fut une réflexion sur le monde contemporain.
Pays : France/Vietnam